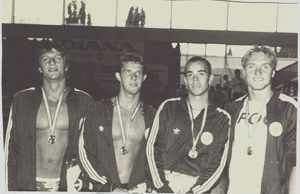|
|||||||||
|
|
Petite histoire du SFOC Au Stade Français, ce n'est qu'en novembre 1925 que la décision fut prise de se jeter enfin dans le grand bain de la natation de compétition. L'absence de piscine explique le retard avec lequel on arborait alors l'un des principaux sports de base. Au cours de ces quinze premières années, l'histoire de la natation « bleu et rouge » se forge au gré de séances d'entraînement dans les piscines parisiennes, et s'illustre d'un premier titre de champion de France, pour l'équipe du 4 x 100 m nage libre, en 1933, puis d'un second en 1935, pour l'un des meilleurs nageurs français de l'avant guerre, Jacques Cartonnet, recordman du monde du 200m en brasse. Entre 1947 et 1954, c'est au moins un titre qui revient aux Stadistes, grâce aux performances de Josette Aresne-Delmas et de Maurice Lusien, qui dominent la brasse française. A partir de 1954, une brillante équipe de jeunes se constitue autour de Christine Caron , que la France appelle affectueusement «Kiki» et qui deviendra championne des USA et médaille d'argent au J.O. de Tokyo en 1968.
|
||||
|
En juin 1973, une rencontre entre dirigeants Stadistes dont Claude Baehr et Gérard Monnet et les responsables du sport à Courbevoie, notamment Pierre Marot, directeur du Centre Olympique de Courbevoie (C.O.C.), conduit à imaginer une expérience originale et même exemplaire, en associant un grand club sportif et une municipalité. Le Stade dispose d'un potenciel de haute valeur, et Courbevoie déplore l'absence d'une élite sportive dans le magnifique ensemble nautique qu'elle vien d'inaugurer. Le 11 septembre 1973, l'acte de naissance du « Stade Français Olympique Courbevoie » (S.F.O.C.), est signé Le maire de l'époque en devient le premier président, et André Vernières, président du Stade Français, le premier vice-président. Le S.F.O.C. gravit les échelons de la renommée sportive. Pierre Baerh et Sylvie Testuz, demi finaliste du 100 mètres dos aux J.O de Montréal en 1976, collectionnent les titres et de nombreux jeunes apparaissent au palmarès des compétitions.
|
|
||||
|
|
La moisson des médailles se poursuit avec Véronique Jardin, plus de 20 fois Championne de France en dos et en libre et sélectionnée aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. 1981 est une date capitale dans la vie du club. Alex Ferenczfy décide de renoncer à ses activités et propose pour le remplacer Jean Pommat, un de ses anciens grands nageurs. Mais la natation française poursuit son évolution vers un semi-professionnalisme amenant les clubs à pratiquer une politique de recrutement pas toujours très honorable, et à laquelle aussi bien le Stade Franais que Courbevoie refusent de souscrire. Dans le même temps, la Fédération Française de Natation met en place une structure parallèle avec la création de centres d'entraînement de haut niveau dans différentes régions de France, se posant en concurrente de ses propres administrés.
|
|
|||